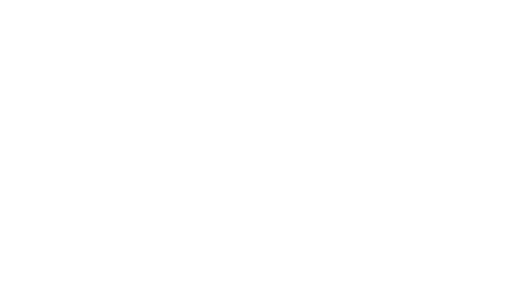Vous souhaitez des collaborateurs en bonne santé, épanouis et pleinement engagés dans leur travail ?
Adhérer à l'OSTIE, c'est leur offrir la garantie d'une prise en charge de qualité et le prestige d'une institution reconnue depuis 1955 pour son expertise en Santé et Sécurité au Travail à Madagascar.
Nos services
L'OSTIE propose à ses affiliés et à leur famille une gamme de soins complète, conforme aux normes les plus élevées de la médecine, couvrant tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail pour les accompagner à chaque étape de leur vie.

Sécurité et Santé au Travail

Médecine Générale

Médecine Spécialisée

Imagerie médicale & Laboratoires d'analyses
Multimédia
L'OSTIE propose à ses affiliés et à leur famille une gamme de soins complète, conforme aux normes les plus élevées de la médecine, couvrant tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail pour les accompagner à chaque étape de leur vie.



Ils nous font confiance













































Nos
Chiffres
+250
Personnel Technique
+56
Antennes
+175000
Affiliés
+4000
Adhérents
+9
Dispensaires